|
La conversion analogique-numérique repose sur deux
opérations fondamentales que sont l’échantillonnage
et la quantification.
- L’échantillonnage consiste à prélever des
petits échantillons de son (ce qui revient à mesurer des
différences de pression) à des intervalles de temps
précis. L’intervalle de temps entre deux échantillons
est appelé fréquence d’échantillonnage ou encore taux
d’échantillonnage. Le nombre d’échantillon par seconde
s’exprime en Hertz (Hz). La fréquence d’échantillonnage
est un paramètre très important de l’échantillonnage car
elle définit la qualité de l’enregistrement. En effet,
plus la fréquence d’échantillonnage est élevée, plus
l’intervalle de temps entre chaque échantillon est
faible et donc plus fidèle sera le signal final au
signal initial. Par contre il est évident que plus la
fréquence d’échantillonnage sera élevée, plus le nombre
de donnés à stocker est importante donc plus le signal
nécessitera une mémoire importante. Le théorème de
Nyquist-Shannon stipule que cette fréquence doit
être égale ou supérieure à deux fois la fréquence
maximale du signal afin que le signal ne soit pas
perturbé par l’échantillonnage. Ce théorème a permis de
mettre au point une fréquence standard : sachant que
l’oreille humaine ne perçoit les sons que jusqu’à une
fréquence d’environ 20 kHz, la fréquence
d’échantillonnage doit être supérieur ou égal à 40kHz,
la valeur précise de 44.1kHz a été choisie comme
standard. Elle provient des contraintes de
synchronisation avec les équipements vidéo. Ceci permet
de ne pas traiter les sons inaudibles qui ne
présenteraient aucun avantage pour une écoute humaine
ultérieure du signal échantillonnée.
- La deuxième opération, la quantification,
consiste à remplacer les valeurs exactes analogiques de
l’échantillon par la plus proche valeur binaire
possible. Donc à chaque échantillon est associé un
nombre binaire. Ce dernier détermine la valeur
approximative de la pression du fluide de propagation
(de l’air, en règle générale), à un instant donné. Le
son n’est plus représenté par une courbe continue mais
par une suite de valeurs discrètes sur chaque intervalle
de temps. La quantification est caractérisée par un
paramètre nommé résolution. Il détermine le nombre de
valeurs différentes qu’un échantillon peut prendre,
aussi appelé nombre de bits. De même que pour la
fréquence d’échantillonnage, plus la résolution est
élevée, plus grande est la qualité de l’information et
le besoin en mémoire, ainsi que le prix du composant est
élevé. Avec un nombre de bits x on a 2x
possibilités de valeurs. Par exemple un signal de 16
bits (2 octets) va donner 216 possibilités de
solutions différentes, ce qui va permettre de coder le
niveau du signal entre -32767 et 32768. Le choix du
nombre de bits du convertisseur va conditionner aussi
l’étendu du signal que l’on peut capter. A 1 kHz la plus
petite variation de pression détectable par l’oreille
humaine est de 2 x 10-5 Pa, si l’on attribue
à cette variation de pression la valeur de 1 du
convertisseur analogique sélectionné. Pour un
convertisseur 16 bits alors la valeur maximale de 32768
correspond à un son d’intensité relative de 90 dB soit
le niveau sonore d’un orchestre symphonique. Pour un
convertisseur 24 bits le signal peut être codé entre
-8388607 et 8388608. La valeur de 8388608 correspond à
un son d’intensité relative de 138,5 dB soit un niveau
sonore correspondant au seuil de l’intolérance. Le seuil
intolérable du système auditif humain est compris entre
130 dB et 140 dB. A l’enregistrement bien qu’un
convertisseur 16 bits soit suffisant généralement on
travaille à des résolutions supérieures (20,24, voir 32
bits) pour avoir une plage de manœuvre plus importante.
Numériser à haute résolution permet de garder une
qualité optimum.
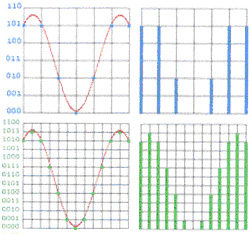
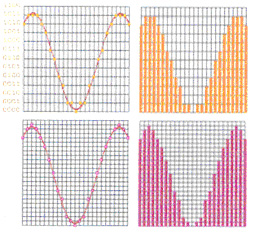
Figure 2 : Evolution de l’échantillonnage en fonction de
la fréquence et de la résolution. |





